"Ailleurs, c'est forcément mieux"
"C’était au mois de mai. Sa saison préférée. Elle était si
belle dans sa robe à coquelicots flamboyants. Elle était si belle, tout
simplement.
Les jours de grande fatigue, je peux encore entendre son
rire. Il vient me bercer avec cruauté. Il flotte tout autour de moi et son
parfum me revient. Un parfum de fleurs orientales, de poivre et de bergamote
entremêlés. Précis et structuré à la surprenante désinvolture, tout comme elle.
Je la revois ce dimanche-là, sur les berges de la Seine.
Elle irradiait plus encore que le soleil. Elle fredonnait cet air qu’elle
aimait tant et qui m’oblige encore aujourd’hui à changer de station lorsqu’il
passe sur les ondes. Le souvenir d’un bonheur parfait, total et perdu est si
douloureux qu’il est préférable de l’anéantir jusqu’à le faire disparaître.
Les jours de grande colère, sa longue main vient même se
glisser dans la mienne. Je peux ressentir jusqu’à la finesse de son grain de
peau me caresser la paume en cadence. Elle disait que ressentir les choses
était une force et non une faiblesse. Elle disait que ceux qui pensaient
l’inverse n’étaient que de pauvres fous condamnés à vivre petit, à penser
petit, à ressentir petit et à mourir petit. Elle ajoutait avec sérieux que rien
ne valait de vivre petit. Rien de rien,
mon Charles, tu comprends ? Et je comprenais. Enfin, à ses côtés, je
comprenais. Auprès d’elle, tout devenait éblouissant et limpide. Elle avait ce
formidable don de transformer les choses les plus sombres en féerie
multicolore.
Je me souviens de ce jour, encore plus qu’un autre, sans pouvoir
m’expliquer pourquoi celui-là précisément. Ce dont je suis certain, c’est que
lorsque je baisse ma garde, c’est toujours lui qui me cueille. Ce banal jour de
printemps sans rien de particulier, à être simplement heureux, côte à côte.
Ma mère aimait Paris. Elle aimait y vivre, y flâner, y
inventer. Nous aimions Paris. Notre appartement modeste de la rue Stendhal
situé dans le XXème arrondissement tout près du cimetière du Père Lachaise et
nos habitudes de petit couple qui amusaient les commerçants du quartier. Nous
avions choisi de nous y installer lorsque nous avions compris que mon père ne
reviendrait pas. Il nous avait fallu, à elle comme à moi, une année entière
pour voir disparaitre nos dernières lueurs d’espoir. C’est tenace l’espoir
lorsque l’amour s’en mêle. Et nous, nous l’aimions. Il était intelligent, il
était beau, il était drôle. Et surtout immensément superficiel. Un jour, un
joli jupon lui a tourné la tête et le drôle d’oiseau qu’il était s’est envolé. Comme
ça, sans un au revoir, sans une explication, sans plus donner signe de vie. Un magicien des temps modernes, tentait de
me consoler ma mère en me serrant fort contre sa poitrine pour écraser ses
sanglots.
Une fois ce chagrin admis et notre existence redessinée, notre
destinée avait repris son cours. Ma mère avait une aptitude rare pour le
bonheur. Elle accueillait la vie à bras ouverts et cette dernière semblait le
lui rendre au centuple. Elle voyait toujours le bon dans le mauvais, la trouée
dans les nuages. Elle savait la fugacité des orages et la beauté des
arcs-en-ciel qui leur succédaient parfois. Elle regardait l’avenir et
s’appliquait à virevolter dans le présent. Ne
regarde pas en arrière, mon Charles, ça ne sert à rien, on ne réécrit jamais
l’histoire. Cours vers le futur et surtout, jette-toi à corps perdu dans le
présent.
Je n’ai jamais rien su de son passé à elle. Lorsque je
m’essayais à quelques curiosités, elle les évinçait dans un sourire
d’insouciance qui sonnait faux. Je n’insistais pas. Je n’aimais pas la plonger
dans l’embarras, et puis surtout, cela lui allait si mal… Je n’avais pas de
grands-parents, ni d’oncle, ni de marraine comme tous mes camarades de classe.
Je n’avais qu’elle. Elle était toute ma vie et elle la remplissait à la
perfection.
Elle était ma princesse, mon héroïne, mon impératrice, ma
muse, mon guide, mon ange gardien, mon mentor, mon pygmalion.
Une poésie percutante de Prévert, une partition audacieuse
d’Haydn, un déconcertant tableau de Klimt[1], une comédie dramatique de
Truffaut, un bronze subjuguant de Brâncuși[2].
Elle était ma mère.
Mon champ de coquelicots, mon océan, mon abîme.
Et je sais bien qu’en la perdant, je m’y suis perdu."
[1]
Gustav Klimt (1862-1918) peintre symboliste autrichien appartenant au
mouvement Art nouveau.
Cet extrait vous a plu ?
Pour commander ce roman cliquez Ici
"Roue libre en kaléidoscope"
Introduction
***
L’air rouge et compact entre dans ses poumons
avec ce
détestable goût d’eau stagnante.
Le métal, d’un bleu glacier
aux
inquiétants reliefs turquoises,
glisse sous
ses doigts paniqués.
.La musique assourdissante, opaque et visqueuse,
s’insinue
dans chacune de ses terminaisons.
La peur, saillante et tentaculaire,
bat le sang
au creux de ses tempes.
L’odeur de salpêtre vert-de-gris se mêle
à celle,
sournoise,
d’ambre cireuse.
La porte inconnue s’ouvre. Il est là, tel
une ombre.
Spectateur, maître, abject.
Ses lèvres, à la finesse masculine
dérangeante,
s’articulent avec perversité pour prononcer l’indicible.
L’insupportable.
Cinq lettres sifflées en dégradé d’ocre
qui glacent
et figent sa mémoire.
« Viens... »
« Viens... »
Le grain de diable dans le rouage.
***
Chapitre 25 : Sombres aveux
"Ce fut le jeudi suivant.
Le jour des saints Innocents, comme la vie est cynique.
La veille, Falineau
s’était arrangé pour croiser Bournezeau et lui avait proposé, comme souvent, de l’accompagner à la chasse. L’autre avait
accepté d’une mine réjouie de charcutier qui venait d’égorger un cochon. Falineau
n’en avait pas fermé l’œil de la nuit. Le lendemain, ils avaient marché un bon
quart d’heure et quand Claude avait jugé qu’ils s’étaient suffisamment enfoncés
dans les bois, il avait mis en joue l’homme d’église.
Il l’a fait mettre à
genoux sur le tapis de feuilles encore gelées et l’a fait avouer. Ce serait
mentir que de dire qu’il n’a pas éprouvé un certain plaisir à la lecture de
l’angoisse morbide sur le visage gras. Ce plaisir délictueux de la vengeance
qui n’appartient qu’aux hommes. Il a savouré les tressaillements de son menton
pointu, les distorsions grotesques de sa bouche qui suppliait, ses larmes de
repentance. Il a songé à son fils qui, lui aussi, avait dû connaître la peur,
l’impuissance et la fatalité. A cette pensée, Falineau n’a plus été seulement
ce père meurtri dans sa chair et dans son âme, mais un être tout puissant,
investi d’une mission punitive. Sanguinaire. A la frontière de la barbarie. A
coups de crosse anglaise dans les testicules, il l’a forcé à parler, à
raconter, à se déverser en détails jusqu’à l’inaudible. A quatre pattes sur le
sol, le pantalon souillé, il l’a regardé implorer le pardon. Falineau l’a
obligé à marcher ainsi, telle la bête difforme qu’il était. Et quand le
spectacle et les aveux lui ont porté au cœur, il lui a ordonné de se relever et
de courir à travers bois sans se retourner. Bournezeau a hésité. Etait-ce son
heure ou son salut ? Dans un sursaut de survie, il s’est mis à courir en
conjurant le ciel. Sans se retourner.
Claude, 38 ans,
charpentier, marié depuis 16 ans à Angélique, père de Nolwenn, Elsa et Loïc a
armé son Darne[1]
calibre 12, a visé sa proie qui trébuchait sur les branches mortes puis a
appuyé en toute conscience sur les queues de détente. Deux gerbes de
chevrotines sont sorties des canons rutilants et la multitude de plombs est
allée se nicher dans les poumons, les reins et la moelle épinière du prêtre.
L’homme, à seulement huit mètres, est tombé à terre dans un râle animal qui a
empli le chasseur de satisfaction.
Falineau l’a regardé
agoniser jusqu’à ce que l’hémorragie ait raison de lui et qu’un filet de sang
vienne border sa bouche libidineuse. Puis il a vomi."
Ces extraits vous ont plu ?
Pour commander ce roman cliquez Ici
"La vie rayée"
Chapitre 37 : Les mots qu'on ne dit jamais
"Ce fut aux heures les plus sombres de la nuit que les petits
mots choisirent de s’évader des lèvres de Paul-Ely. Après un énième amour, il s’était
levé afin d’aller chercher de l’eau fraîche. En revenant près du lit, il s’était
accordé le luxe de la contemplation.
Elle était si belle… Si belle… D’une beauté insolente, à la
frontière de l’insoutenable. Il se sentit à la lisière du monde.
–
Je
t’aime…
Elle s’était
laissée observée, avait soutenu son regard un long moment, puis lui l’avait
invité.
–
Viens…
Il
s’était allongé près d’elle et Harmonie l’avait entouré de son amour à elle. Le
silence avait envahi la chambre. Un silence menaçant et avant-coureur. Paul-Ely
savait qu’avec ses trois petits mots lâchés en liberté, le cours des choses tout
entier allait changer.
Plusieurs
minutes s’étaient écoulées avant qu’elle ne parle. Sa respiration s’était faite
profonde, palpable.
–
Je
ne crois pas que ce soit de l’amour, mon amour…
Elle
savait sa vie, sa femme, ses enfants, ses engagements auprès de son frère et de
ses sœurs. Elle avait pleine conscience de dérober des moments à la vie, de
fabuleux moments qu’elle n’aurait jamais, ne serait-ce, qu’espéré vivre… Mais
elle savait aussi leur caractère éphémère. Elle aussi aurait pu prononcer ces
mots… Elle était amoureuse. Eperdue même. Mais était-ce de lui ou de ces
instants parfaits ? Au-delà de cela, elle n’était pas femme qui volait
leur vie aux autres. Elle ne voulait pas l’être et ne le serait jamais.
–
Je
sais que tu es sincère, Paul-Ely. Je sais que là, c’est précisément ce que tu
ressens… Mais, soyons raisonnables, au fond de nous, au fin fond de nous, nous
savons…
Ses
doigts jouaient dans ses cheveux bruns avec tendresse. D’adolescent enflammé,
il passa à enfant meurtri. Pourquoi disait-elle cela ? Non, il l’aimait
d’un amour réel… Au tréfonds du fin fond de lui.
–
Nous
ne sommes qu’une parenthèse inespérée, ajouta-t-elle, rien ne naîtra de tout
cela… Ne nous mentons pas. Pas nous.
Quelque
chose se désagrégeait dans ses entrailles. Un organe vital se disloquait. Une
douleur liquide se répandait partout en lui.
–
Tu
es l’homme le plus parfait qu’il ne m’ait jamais été donné de rencontrer. Le
meilleur amant qu’il soit, le plus galant, le plus admirable, le plus
dithyrambique, le plus intelligent aussi… Mais c’est trop tard pour nous. Tu le
sais… Je le sais. Tu es pris, Paul-Ely.
Oh,
Harmonie, cette dernière phrase… Combien j’aurais aimé, mon Harmonie, que tu te
battes et non que tu te résignes. J’aurais donné toutes mes richesses pour que
tu me supplies de tout quitter par amour pour toi, que tu invoques l’impossible
et le rendes éventuel.
Tu
étais donc si parfaite que même ta raison ne l’emportait pas sur ta
passion ? Car je sais que tu m’aimes, je te sens sous ma peau onduler
d’amour démesuré et d’espérance… Si tu savais combien je meurs de tes mots
prononcés dans cette chambre. Combien ils blessent et pourtant, je sais d’avance
que je ne t’en voudrais jamais de ce mal qui arrive par toi. Même la souffrance
venant de toi m’apparaît comme délicieuse.
–
Tu
ne réponds rien ?
Non,
il n’arrivait à rien répondre. Il troqua d’inutiles mots contre un baiser. Un
baiser aux allures de gouffre, de déclaration originelle.
Il
savait qu’elle avait raison. Il n’était pas non plus homme capable d’abandonner
les siens… Il n’avait pas ce courage.
Il
avait été le lâche qui s’était laissé entraîner par ses désirs et resterait le
lâche qui ne les assumerait pas pleinement.
Lorsqu’ils
firent l’amour une ultime fois, leurs larmes s’entremêlèrent. Il n’avait jamais
pleuré d’amour, Paul-Ely. Ce serait le souvenir le plus précieux de cette
affolante passion.
Ils
ne reparlèrent plus de ces trois petits mots fugueurs et quittèrent leur éden,
le lendemain, en fin de matinée. Il la déposa chez elle en milieu d’après-midi.
A demain. A demain...
Paul-Ely
regagna son appartement et tous ses engagements, l’âme en cendres.
Il
savait…
Il
avait toujours su qu’il n’aurait pas dû.
A
présent, c’était trop tard. La blessure était là.
Evidente,
transperçante et sans issue.
Quelle saleté cette vie !"
Cet extrait vous a plu ?
Pour commander ce roman cliquez Ici
"Le choix des tricheurs"
Chapitre 61 : Le fardeau
"Contre toute attente,
cette visite éclair porta ses fruits. Mais pas tout de suite.
Avant il fallut que je
regagne Paris, le cœur comme une mise en plis qui aurait pris la flotte.
Je fis l’erreur d’aller
en premier rendre visite à mon père. Je le trouvai seul sur son canapé
faussement médusé par une émission sur canal plus. Je l’embrassai sans qu’il ne
bouge. Il me salua d’un vague Ah, c’est
toi ?… Oui c’était moi. Comme si ce n’était nullement étonnant. Il était
vrai que je ne vivais qu’à cinq cents kilomètres de là, il n’y avait donc rien
de surprenant à ce que je débarque comme cela, à l’improviste… Je m’assis du
bout des fesses sur un autre fauteuil, tout près de lui, les coudes sur mes
genoux. Je le regardai. Ses traits étaient tirés, ses yeux éteints, sa chemise
chiffonnée par, je supposais, une longue série d’embouteillages. Lui,
continuait de fixer l’écran. Moi aussi, j’étais rincée par la route. J’avais
une colonie d’abeilles dans les oreilles qui me faisaient payer chèrement le
prix du volume trop élevé de l’autoradio pendant le trajet. J’essayai d’établir
un contact. Et comment s’était passée
cette journée ? … Où en était-il avec le nouveau catalogue qu’il avait tant de
mal à boucler ? Ah, tiens au fait, J’avais eu Daniel en ligne cette semaine… Et
puis, j’étais contente, j’étais responsable d’un nouveau budget dans mon
agence… Je m’occupais des prises de vues, c’était chouette… Il répondait
vaguement par onomatopées à peine audibles. Je poursuivais mon non-échange. Avait-il dîné ? Voulait-il qu’on aille
manger quelque part tous les deux ? Non… Il n’avait pas faim…
Mon père dans ce pavillon
de banlieue en meulière était un être proche de l’état végétatif. C’était
navrant. Et malgré tout l’amour que je lui portais, je n’avais aucun pouvoir
pour le sortir de ce semi-coma. Il
fallait que ça passe. C’était bien plus qu’un chagrin d’amour. C’était une
déception sur la vie. Une trahison. Encore une. Celle de trop. La troisième. Sa
mère, tout d’abord, qui, à ses quatorze ans, quitta le domicile conjugal et
qu’il ne revit jamais. La mienne, ensuite, qui avait pris le large, il y avait
plus de vingt ans maintenant. Et à présent, sa nouvelle femme qui était partie
avec l’ami de la famille... Un abonné aux abandons. J’en étais malade de le
voir se ronger ainsi… Malade. C’était insupportable de lire sa douleur.
D’assister à ce massacre intérieur sans être capable de lui venir en aide. Un
soir, alors que je m’inquiétais pour lui… Que j’essayais de discuter, de
comprendre ce qu’il ressentait réellement, qu’il le verbalise… Que ça sorte…
Alors que je le torturais de questions, il avait fini par lâcher : "Oh, tu
sais, moi, la psychologie féminine, j’ai décidé d’arrêter définitivement".
— Définitivement ?...
Dommage, Papa, tu as une fille…
— … Oui, dommage…. avait-il soupiré.
Avec cette réponse, je
m’étais pris le plat d’une pelle en pleine tronche.
Voilà où nous en étions
donc, lui et moi. Je quémandais, il distillait au compte-goutte des bribes de
présence. Cela devait être écrit. Et je devais me complaire dans ce type de
relation pour y rester et persévérer.
Tout comme avec
Antoine, j’étais la demandeuse. Tout comme avec Antoine, je m’évertuais à
essayer de me faire aimer. C’était décourageant. Ce soir-là, j’abandonnai.
Fatiguée de ces situations répétitives. J’ouvris un frigo sinistré et improvisai
une salade que je lui servis sur un plateau, devant sa télé. Un plateau beige,
en imitation bois, version cantine, aussi triste que lui. On passa la soirée
dans ce vide navrant et un silence tentaculaire.
J’allai me coucher bien
avant lui, posai un dernier baiser sur sa joue, sans plus de réaction qu’à mon
arrivée. Je ne parvins pas à trouver le sommeil, repassant en boucle la bande
image de ma nuit précédente. Sans y trouver ni réconfort ni lueur d’espoir. Mon
père, de son côté écuma les programmes de toutes les chaînes. Je l’entendis
fermer la porte de sa chambre très tard. Trop tard pour aller bien. J’aurais
tant aimé pouvoir lui parler. Lui
raconter. Lui demander ce qu’il en pensait… J’aurais pris tous les conseils
balancés même à la va-vite entre deux émissions lobotomisantes. Même les plus
défaitistes, les plus sombres, les plus moralisateurs. J’aurais juste voulu
qu’il s’intéresse à moi. Me sentir moins
seule, moins inutile, moins encombrante.
J’aurais tant eu besoin d’aide moi aussi…
Qu’ils étaient durs les
hommes que j’aimais. Qu’ils étaient sévères. Cruels. Rétifs. Pensaient-ils
vraiment que j’étais si forte ? N’auraient-ils pas pu montrer davantage de
bienveillance à mon égard ? Une fois, juste une fois.
Au réveil, j’hésitai à
décrocher le téléphone. Je savais qu’Antoine était à son bureau le samedi
matin. Je me ravisai. Je n’y aurais rien gagné. Je me serais juste enlisée.
J’abandonnai mon père à
son deuil et allai affronter une autre forme de mal-être, celui de ma mère.
Différent. Plus loquace, plus visible, plus installé. Plus dans la colère et la
destruction. On grignota un feuilleté au saumon autour d’un rosé de Loire trop
sucré choisi pour son faible prix. Elle me confia sa fatigue, ses rancœurs, ses
psychotropes. Je lui narrai l’épisode raté de ma virée limousine. Les flics, la
pluie, le chanteur espagnol, le désintérêt d’Antoine, ma frustration, mes
peurs. Ça fit l’effet d’une bombe, une aubaine pour déverser sa haine. Elle le
lapida. Il fut cagoulé, traîné par une
douzaine d’hommes, ligoté à un poteau puis fusillé sur le champ.
Je restai là, muette,
sur ma chaise en paille toute chancelante, abasourdie par ce spectacle
sanglant. Étonnée de réussir à l’être encore de ses réactions si violentes. Ma mère
était la championne du monde pour montrer patte blanche, inspirer la confidence
et la seconde qui suivait, planter un couteau dans le dos. Je m’étais encore
fait avoir. Une fois de plus. La bête était lâchée, plus rien ne pouvait
l’arrêter. Je regrettai amèrement de m’être épanchée et j’attendis impassible
que l’orage passe. Quand elle en eût terminé avec lui, ce fut au tour de sa
voisine que l’on amena elle aussi sur la place publique. Le même châtiment lui
fut administré, sans appel. Vinrent ensuite deux de ses collègues, pas mieux
lotis. Puis une ex-amie, écartelée, le
mari de je ne compris pas qui, décapité et le vigile de la supérette fut pendu
haut et court. Mon père se prit une centaine de coups de fouet au passage. Le
massacre se propagea jusqu’en Bretagne puis elle partit chercher de nouvelles
cibles en farfouinant dans un sordide passé. Et il y avait de quoi faire. Un
père alcoolique qui dépensait au bistro toute la paie d’une mère courage
garde-barrière, une enfance dans une cahute en terre battue… Le manque, la
faim, le froid, la peur… Et cette malle qu’elle cloua de ses propres mains à
ses quatorze ans où elle entassa toutes les affaires de son géniteur en lui ordonnant
de disparaître à jamais. Pour sûr, de la matière, il y en avait. Je savais
parfaitement quelles seraient les prochaines victimes. C’en était trop. Je me
dépêchai de vider ma tasse de café soluble. Je ne voulais pas entendre une
énième fois combien Pépoche et Manoushka m’avaient volée à elle. Combien elle
avait souffert… Combien ils avaient été injustes… Je voulais me sauver avant
même d’entendre les premiers chefs d’accusation. C’était un procès sans avocat.
Sans juré. Ce n’était même pas un procès d’ailleurs. Juste une condamnation. La
redif. Je regardai ma montre et prétextai un rendez-vous fictif avec Lou… Mais,
tu pars déjà ? Oui, je partais déjà Maman…
Bien sûr que je
partais. Tu resterais, toi ? Tu resterais là, sans rien dire à te faire
saccager l’âme ? Tu es si cinglante, tellement blessante. Tu ne vois pas le mal
que tu me fais ? Tu ne te rends pas compte que tu me déchiquètes depuis que je
suis arrivée ? Tu ne devines donc pas combien j’aurais eu besoin
de douceur, moi aussi ? Une Maman, c’est censé voir, non ? C’est censé apaiser,
protéger, cajoler, rassurer... Tu ne sens pas mon désespoir, mon cœur souillon,
mes idées guenilles ? Et mes yeux, mes grands yeux gris que tu dis trouver si
expressifs, ne vois-tu donc pas combien ils sont tristes ? Non, tu ne voyais
plus rien… Ma Maman aveuglée par ses douleurs et ses angoisses. Etouffée par sa
bile haineuse.
Mais je ne dis rien… Je
l’embrassai avec tendresse en lui demandant de prendre soin d’elle… Je la pris
dans mes bras et la gardai un instant tout contre moi. Je la sentis toute
fragile sous mon étreinte, presque tremblante. Ma culpabilité se mêla à ma
peine. Mais que pouvais- je bien faire ? Il fallait que je sauve ma peau moi
aussi. Je refusai qu’elle m’emmène dans son naufrage. Et le naufrage arrivait…
Comme une marée montante. Cette femme autrefois si solide, si brillante, si
combative se disloquait, s’effritait au fil des mois. Mais que pouvais-je
réellement faire ? On ne pouvait pas aider quelqu’un qui vous empêche de le faire.
Était-ce mon rôle ? Était-ce cela la vie ? Naître d’un couple qui ne s’aimait
déjà plus et grandir avec un autre ? Connaître les plus belles années de sa vie
avec des gens aimants et protecteurs, se construire ailleurs en occultant d’où
l’on vient pour étouffer cette honte si douloureuse d’avoir été rejetée.
Bannie. Exilée. Pour au final quoi ? Être arrachée à eux, cinq ans plus tard ?
Croire que la vie s’arrête tant la douleur est insoutenable. Arriver à
l’espérer même… Apprendre à vivre avec ça, se relever, en boitillant mais
continuer. Et puis attendre. Attendre et encore attendre. Attendre d’être
grande et libre. Et le jour enfin venu, récupérer le fardeau de ces vies ratées
?
Non, je n’étais pas
certaine de le vouloir. Encore moins d’en être capable. Je n’en voulais à
personne dans l’histoire… J’aurais seulement aimé que l’on me laisse en paix
afin que je puisse vivre enfin Ma vie
à moi. Je n’avais pas le pouvoir de réparer les erreurs de parcours, les
mauvais choix, les sorties de route. Je n’avais pas la carrure. Vraiment pas.
Je remis en place une
de ses mèches blondes vénitiennes, l’accrochai derrière son oreille, regardai
ses jolies taches de rousseur, ses yeux marron, profonds et embués. Las. Elle
sentait bon le chèvrefeuille, ma brindille de Maman.
Je l’aimais aussi fort
que je devais la fuir. Je l’abandonnai à ses marécages et à sa solitude, la
laissant me faire des signes sur le pas de sa maisonnette. Je fis un peu
l’andouille en sautillant dans l’allée histoire de lui arracher un dernier
sourire avant de la quitter. Pour noyer ma lâcheté dans sa fierté. Sa fille, si
drôle, si vivante…
On ne pouvait pas
toujours courir plus vite que les avalanches… Je m’effondrai sur le siège chiné
de ma Supercinq. Je vis le ticket du péage de la veille qui traînait sur le
tableau de bord, ma gorge me fit mal, mes bras aussi. Un match de basket ! Voilà
ce que je valais. Moins qu’un match de basket.
Je fondis en larmes. Je
n’y arriverai pas…
Mais où allais-je dans
cette vie ? Y avait-il quelqu’un sur cette terre qui allait m’aider et me le
dire ?"
Cet extrait vous a plu ?
Pour commander cliquez Ici


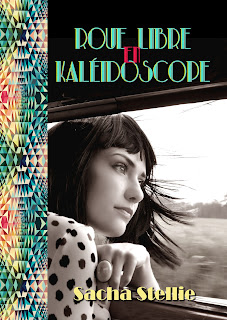
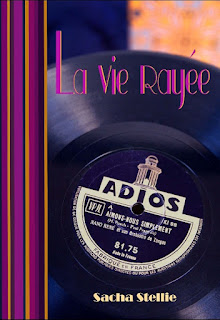

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire